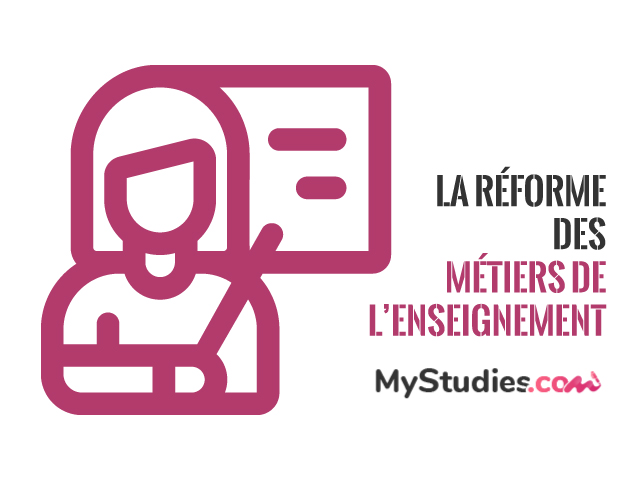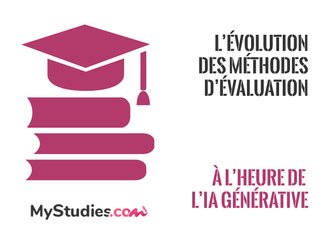Pourquoi cette réforme ? – État des lieux de l’éducation en France en 2025
Si cette réforme s’inscrit dans le cadre des allégations de l’immobilisme de François Bayrou depuis l’adoption du budget en début d’année, elle répond également à des enjeux, qui avaient été mis en évidence dans le projet de réforme de l’ancienne ministre de l’Éducation, Nicole Belloubet.
La chute du niveau scolaire en France
Il est bien connu que le niveau scolaire des élèves français est en baisse. L’enquête Trends in International Mathematics and Science Study (Timss) menée en 2023 a par exemple positionné la France à la dernière place en Europe en ce qui concerne les compétences en mathématiques des élèves de CM1, et en avant-dernière position pour les élèves de 4e, un niveau qui reste malheureusement inchangé depuis 2019. Nous pouvons aussi mentionner les scores PISA qui témoignent d’une dégringolade des performances en lecture (compréhension de l’écrit) et en sciences.
Le niveau scolaire global est aussi à mettre en perspective avec les inégalités sociales, se matérialisant par une fracture éducative bien ancrée et difficile à enrayer.
La baisse du nombre de candidats aux concours de l’enseignement
La pénurie d’enseignants n’est pas une question récente. Le métier d’enseignant a en effet peu à peu perdu en attractivité. Nous pourrions trouver plusieurs raisons à cela, notamment la dégradation des conditions d’enseignement et des salaires plus bas que dans les pays voisins. Selon Elisabeth Borne, depuis 2021, les inscriptions dans l’enseignement primaire ont baissé de 45 % et celles dans l’enseignement secondaire, de 21 %. Cela se traduit par de nombreux postes vacants : en 2023, 3 100 postes sur les 23 800 ouverts aux concours ont été non pourvus. Cela donne lieu à des classes sans enseignant, ce qui alimente la baisse du niveau scolaire, ainsi qu’au recrutement forcé de contractuels.
Un manque de maitrise des connaissances à enseigner
Les inspecteurs soulignent que la formation actuelle ne garantit pas l’acquisition des connaissances requises pour enseigner au primaire (Eléa Pommiers, 2025). Les enseignants sont en effet mal préparés en comparaison à leurs collègues européens, que ce soit dans la maîtrise des matières à enseigner ou dans la gestion de classes hétérogènes.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la réforme de la formation des enseignants, essayant de trouver des solutions à ces écueils.
Que dit la réforme ? – Une pierre deux coups
La réforme de la formation des enseignants concerne les enseignants dans le 1er et le 2de degré ainsi que les conseillers principaux d’éducation. Nous pouvons distinguer deux thématiques principales : la formation et le recrutement.
Une meilleure formation du corps enseignant
L’une des modifications clés de cette réforme est l’introduction d’une licence professorat des écoles (LPE) dès la rentrée 2026. Cette dernière vise notamment à améliorer la lisibilité du parcours académique dans l’éducation (Sylvie Lecherbonnier et al, 2025). Elle permettrait en effet aux jeunes de s’orienter vers les métiers de l’enseignement dès la sortie du baccalauréat, sans avoir besoin de poursuivre des études universitaires jusqu’au niveau master, comme c’est le cas actuellement avec la formation MEEF. Cette formation en trois ans vise à étayer les connaissances des étudiants dans les matières qu’ils enseigneront, tout en leur fournissant des outils pédagogiques spécifiques à l’éducation. De plus, cette formation inclut un stage de 10 semaines, offrant ainsi aux étudiants une expérience pratique en vue de leur future carrière.
Un recrutement anticipé des enseignants
La mise en place de cette licence a permis d’ouvrir les concours (CRPE, CAPES et concours de recrutement de conseiller principal d’éducation) aux étudiants ayant validé un niveau Bac+3. Ils sont ainsi recrutés à la fin de la Licence au lieu de devoir attendre de valider leur Master. Cela vise à attirer davantage de candidats et à faciliter leur intégration progressive dans la profession (Sylvie Lecherbonnier et coll., 2025).
Pour faire suite au concours de recrutement, une formation de deux ans rémunérée et « professionnalisante » sera instaurée. Les étudiants de première année seront considérés comme élèves fonctionnaires en académie et percevront une rémunération de 1 400 euros net, tandis que les étudiants en seconde année seront fonctionnaires stagiaires avec une rémunération de 1 800 euros net. Ainsi, même si la formation pour accéder au métier reste de 5 ans, la rémunération est plus attractive durant les deux années de Master (Marie-Christine Corbier, 2025). À la fin de ces deux années de formation, les étudiants obtiennent leur titularisation : cela les engage à servir dans la fonction publique pendant une durée minimale de 4 ans. Cette formation se veut aussi professionnalisante avec un temps accru sur le terrain et une mise en responsabilité face aux élèves.
Qu’est-ce que cela implique ? – Un projet qui ne fait pas l’unanimité
Ne pas confondre vitesse et précipitation
La réforme de la formation des enseignants entraîne une refonte des programmes d’études, avec des délais serrés (Frederic Becquemin, 2025). Les décisions prises par le Premier ministre et la ministre de l’Éducation nationale ont entrainé une grande confusion chez les enseignants et les membres de l’administration, se traduisant par une rentrée universitaire instable : emplois du temps désorganisés, contenu incomplet voire inadapté aux compétences visées, perte de cohérence … nombreux sont ceux qui remettent en cause la qualité d’un programme qui doit être révisé à la hâte. Cette confusion se fait entendre, notamment par le biais des manifestations et des assemblées générales des enseignants-chercheurs.
Un risque de dégradation de la qualité de l’enseignement
Un autre problème de vitesse est celui du recrutement, car les étudiants passant le concours après seulement trois années de formation disposeront d’un bagage de connaissances inférieur et seront moins bien préparés (Sylvie Lecherbonnier et al., 2025).
Par ailleurs, les syndicats ont soulevé plusieurs craintes quant au devenir de la réforme. Les étudiants en M2 devant passer la moitié de leur formation sur le terrain, il ne faudrait pas qu’ils soient considérés comme une main d’œuvre à mi-temps.
De plus, l’effacement de la formation universitaire des futurs enseignants, qui apprendront le programme de l’école primaire en lieu et place de la méthodologie de la recherche, inquiète aussi les syndicats quant à l’impact que cela aura sur les compétences des futurs titulaires (Eléa Pommiers, 2025).
Les universités face à des décisions unilatérales
Un autre reproche formulé par les enseignants-chercheurs lors de leur mobilisation est l’absence de consultations préalables avec les établissements (Frederic Becquemin, 2025). Cette absence de dialogue entraîne des incompréhensions et une déconnexion entre les objectifs fixés et la réalité du terrain. L’opposition syndicale revendique dès lors une suspension de la réforme pour laisser le temps à une concertation de se mettre en place afin de prendre en considération les points de vue de tous les acteurs concernés.
La modification du concours de recrutement (CRPE)
Le nouveau concours CRPE présentera deux phases. Premièrement, les épreuves d’admissibilité, à l’écrit, visent à évaluer les connaissances des candidats dans les matières enseignées dans le 1er et le 2de degré. En second lieu, les épreuves d’admission se composeront d’un exposé et d’un entretien. Les étudiants de la licence LPE seront exemptés des épreuves écrites au concours et pourront se présenter directement aux épreuves d’admission à partir du concours 2028. Pour certaines personnes, cette exemption revient à déléguer l’évaluation des compétences écrites des étudiants aux universités (Eléa Pommiers, 2025), sans allouer de financement spécifique pour ce faire. De plus, cette mesure pourrait menacer l’équité envers les candidats qui ne seraient pas soumis aux mêmes sujets et critères d’évaluation.
Pour conclure, si l’objectif de la réforme est une amélioration de la formation des futurs enseignants, les mesures annoncées ne convainquent pas encore et font plutôt craindre une dégradation de la qualité. Les syndicats appellent à une discussion ouverte sur le sujet afin d’aborder la prochaine rentrée avec sérénité.
Sources
Eléa Pommiers. (2025). Réforme de la formation des enseignants : pour le premier degré, une future licence aux multiples inconnues. Le Monde. https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/04/15/reforme-de-la-formation-des-enseignants-pour-le-premier-degre-une-future-licence-aux-multiples-inconnues_6596283_3224.html
Frederic Becquemin (2025). Réforme de la formation des enseignants : les universités prises de court par un calendrier chaotique. Mediavenir. https://www.mediavenir.fr/reforme-de-la-formation-des-enseignants-les-universites-prises-de-court-par-un-calendrier-chaotique/
Marie-Christine Corbier (2025). Concours, salaire… ce que prévoit la réforme de la formation des enseignants. Les Échos. https://www.lesechos.fr/politique-societe/education/concours-salaire-ce-que-prevoit-la-reforme-de-la-formation-des-enseignants-2156878
Sylvie Lecherbonnier, Soazig Le Nevé et Eléa Pommiers (2025). Education : en déplaçant les concours à bac + 3, François Bayrou et Elisabeth Borne relancent la réforme de la formation. Le Monde. https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/03/28/enseignants-en-deplacant-les-concours-a-bac-3-francois-bayrou-et-elisabeth-borne-relancent-la-reforme-de-la-formation_6587206_3224.html