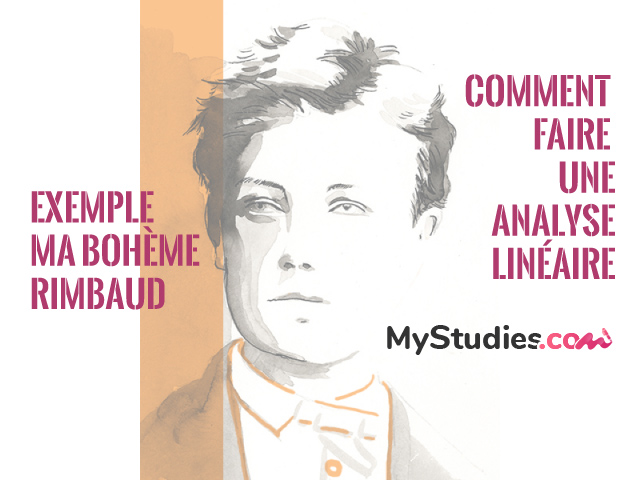Dans un premier temps, la mise en contexte de l'œuvre est importante ; pour un poème de Rimbaud, il est essentiel de définir le mouvement symboliste.
1. Le contexte avec le mouvement littéraire
Le symbolisme est un mouvement de la fin du XIXème siècle dont les auteurs, majoritairement des poètes, portent un regard sur le monde au travers de symboles. L’univers décrit s’éloigne du réalisme par une association entre les sens et l’immatériel, parfois même le sacré. Dans les éléments qui devront être analysés, il faut retenir la musicalité dans les vers, l’appel aux sens, mais aussi un vocabulaire riche avec des métaphores.
2. La versification
Une fois que les premiers thèmes sont évoqués et sont mis en lumière dans le poème, une rapide analyse de la construction de la versification est nécessaire. Les vers pairs (un nombre pair de syllabes) sont les plus utilisés dans la poésie traditionnelle.
Ici, dans Ma Bohème, tous les vers sont en alexandrin (12 syllabes) : c’est la versification que l’on associe aux genre nobles de la poésie, il s’agit donc d’un élément qui nous indique que le poème respecte les caractéristiques de la poésie traditionnelle.
Cas particuliers :
- Le “e” muet ne se compte que s’il est suivi d’une consonne ;
- Faire une diérèse pour séparer un mot en deux (lion -> li-on) ;
- Faire une synérèse lorsqu’on le prononce en une seule syllabe (lion).
Ensuite, on repère le système de rimes. Dans Ma bohème, les rimes sont embrassées dans les deux quatrains, suivies pour les deux vers du premier tercet, et les autres sont embrassées. Les rimes sont riches lorsqu’elles ont trois sons ou plus en commun.
Ici, nous reconnaissons la structure globale du sonnet : deux quatrains suivis de deux tercets. Les rimes attendues dans un sonnet sont celles qu’on retrouve ici : ABBA ; ABBA ; CCD ; EED.
Enfin, on repère les effets de la construction des vers sur le rythme du poème. En effet, on cherche ici à identifier le rejet (la phrase commence au début du vers et se termine au début du vers suivant) ou le contre-rejet (la phrase commence à la fin d’un vers et se poursuit au vers suivant). Ici, si on ne prend pas en compte la phrase en tant que strophe, on peut se baser sur la ponctuation.
3. Les registres
Les registres permettent de comprendre le but de l’auteur, les effets qu’il cherche à provoquer dans le poème.
Dans Ma bohème, Rimbaud évoque ses émotions et ses sentiments personnels en plus de s’exprimer à la première personne, il s’agit alors du registre lyrique.
On peut aussi voir que Rimbaud oppose son expérience merveilleuse à sa condition plutôt pauvre. Mais dans ce poème, le lecteur ne ressent pas nécessairement de compassion pour le poète grâce à son bonheur, donc on ne pourra pas dire que Rimbaud emploie un registre pathétique.
4. Les figures de style
Pour compléter l’analyse, on identifie les procédés et les figures de style qui viendront apporter de la matière pour expliquer davantage les effets qui sont provoqués.
Dans Ma bohème, on ne peut pas observer la tendance de l’auteur à insister par la répétition, on pourra donc mettre de côté les figures de style associées. En revanche, on peut voir que Rimbaud amplifie certains éléments, comme par exemple avec “poches crevées”, “amours splendides”. Quelques figures d’opposition sont visibles avec “un pied près de mon coeur” qui permet ici de les rapprocher. Les figures qui sont les plus évidentes à trouver sont celles qui rapprochent deux termes pour établir une équivalence, pour les rendre comparables. On peut notamment identifier les comparaisons “comme un vin de vigueur”, “comme des lyres”, mais aussi les métaphores “Muse”, “féal”, “j’égrenais dans ma course des rimes”, “des gouttes de rosée à mon front”, “souliers blessés”. Le rapprochement entre l’auteur et le ciel est visible par l’emploie du tutoiement “ton féal”, mais aussi par l’utilisation des déterminants possessifs “mon auberge”, “mes étoiles”.
5. Interpréter
Pour finir l’analyse d’un texte, il faut s’assurer de comprendre le rôle de chaque procédé identifié. Lorsque Rimbaud amplifie le mauvais état de ses poches, on peut penser qu’il montre dans un premier temps sa situation, mais il exprime très rapidement ses sentiments heureux en évoquant qu’il a rêvé de ces fugues. L’antithèse qui oppose “pied” et “coeur” permet en fait de rapprocher deux éléments : le pied fait référence à la fugue, le coeur à l’amour, ici il s’agit de rapprocher ces deux termes afin de mettre en relief la fin du poème : l’amour de la fugue. Les comparaisons permettent d’associer les éléments à des sensations, le vin fait référence à l’ivresse et permet de montrer que la fugue rend heureux le poète, et la musicalité évoquée par les “lyres” permet de comparer les lacets des chaussures à cet instrument. Les métaphores autour du ciel permettent ici de voir le poète comme lui étant soumis puisque la Muse évoque l’inspiration et la féodalité évoque le service. L’auteur s’approprie la nature au gré de ses fugues.
Références :
- Ma bohème, Rimbaud, 1870
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ; Mon paletot soudain devenait idéal ; J’allais sous le ciel, Muse, et j’étais ton féal ; Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !
Registre lyrique : 1ère personne du singulier, interjections et exclamations, termes “féal”, “amours splendides”. | Dans ce quatrain, on retrouve une certaine musicalité grâce à l’expressivité de la ponctuation. Des métaphores. Rimes embrassées, rimes riches “evées” et “éal”. La strophe est une seule et même phrase. |
Exemple pour compter les vers : Je / m’en / a / llais / les / poings / dans / mes / po / ches / cre / vées | On compte 12 syllabes. Diérèses : idé-al ; fé-al |
Mon unique culotte avait un large trou. Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou
Registre lyrique : 1ère personne du singulier, insistances “unique”, “large”, émotions “rêveur”. | Dans ce quatrain, des éléments de musicalité. Des métaphores. Rimes embrassées, rime suffisante “rou” mais répétée 3 fois, rime riche “ourse”. La strophe comprend quatre phrases. On retrouve un rejet du vers 6 au vers 7 ; un rejet du vers 8 au vers 9. |
Mon / u / ni / que / cu / lo / tte a / vait / un / lar / ge / trou | On compte 12 syllabes mais il faut ici associer le “e” de “culotte” et le “a” de “avait”. |
Et je les écoutais, assis au bord des routes, Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;
Registre lyrique : 1ère personne du singulier. | Dans ce tercet, des termes qui font appel aux sens. Des métaphores. 2 rimes suivies, rime riche “oute”. Ces 3 vers poursuivent la phrase commencée à la strophe précédente, mais on retrouve un rejet du vers 10 au vers 11. |
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, Comme des lyres, je tirais les élastiques De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !
Registre lyrique : 1ère personne du singulier, exclamation, terme “coeur”. | Dans ce tercet, des termes associés à la musicalité. Des métaphores. Rimes embrassées en prenant en compte le 3ème vers du 1er tercet. Rime suffisante “eur” et rime riche “astique”. Ces 3 vers poursuivent toujours la même phrase, on retrouve un rejet du vers 13 au vers 14. |