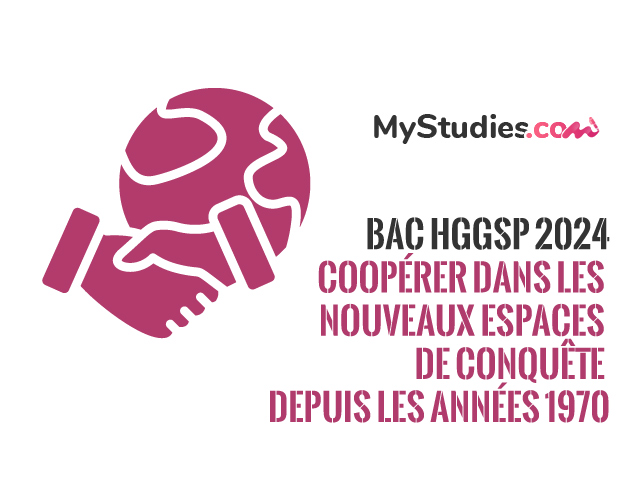Voici une proposition de corrigé concernant la dissertation proposée en 2024 au bac HGGSP qui portait le sujet suivant : « coopérer dans les nouveaux espaces de conquêtes depuis les années 1970 ».
Introduction
Depuis la période de la guerre froide, de nombreux pays sont partis à la conquête de nouveaux espaces, que ce soit l’espace à proprement parler, avec la découverte de planètes, mais aussi les fonds marins ou encore le cyber espace.
Au départ, la grande majorité de ces conquêtes sont clairement marquées par une concurrence accrue, notamment entre des pays comme la Russie et les États Unis. Mais dans les années 1970, de nouvelles dynamiques sont apparues, et le fait de coopérer est apparue comme l’une des solutions les plus évidentes, que ce soit au niveau stratégique, technologique ou encore politique.
En quoi la coopération est-elle devenue peu à peu indispensable dans le fait de conquérir de nouveaux espaces depuis les années 1970 ?
Dans une première partie, nous donnerons les éléments concernant la coopération entre les pays concernant cette conquête depuis les années 1970. Nous donnerons ensuite des exemples significatifs afin d’illustrer nos propos. Enfin, nous étudierons le monde d’aujourd’hui, avec les nouvelles rivalités et les nouveaux défis qui font partie de ces conquêtes.
I. Les bases de la coopération dans la conquête de nouveaux espaces depuis les années 1970
La collaboration après la guerre froide
Dans les années 1970, on assiste à une période qui est fréquemment appelée « détente », et qui est par conséquent plus favorable à une coopération mondiale, sur une grande quantité de points différents.
Ainsi, des projets qui étaient quelques années auparavant marqués par une rivalité importante se retrouvent plus engagés dans un processus collaboratif. L’espace dans tous les sens du terme, que ce soit système solaire, cyberespace ou encore fonds marins, devient un secteur où il est possible de parler de diplomatie scientifique.
En 1975, la fameuse mission Apollo-Soyouz est une forme de symbole de cette volonté de collaboration Russie/ États Unis.
Il y a un nouveau partage des connaissances qui se met en place et de nouvelles puissances arrivent, comme la Chine ou l’Inde par exemple dans le domaine spatial, mais aussi dans le domaine maritime, qui entrainent une volonté de coordination plus globale.
Comme le met en avant Yuval Noah Harari dans Homo Deus, l’avenir de l’humanité repose sur sa capacité à résoudre les plus défis ensemble, et surtout en ce qui concerne l’environnement et la technologie.
Des défis communs à relever
Tous les nouveaux espaces possèdent des critères communs. D’une part, ils sont difficiles d’accès, les explorer et les comprendre coûte très cher, il faut du personnel très qualifié pour cela et ils posent au monde des défis comme la sécurité ou la réglementation, que personne ne peut ignorer.
Il est donc nécessaire d’opter pour une collaboration afin de partager les coûts et les risques, d’éviter toutes formes de conflits, mais aussi pour préserver l’environnement et les écosystèmes d’une manière générale. Il s’agit enfin de s’assurer de la cybersécurité internationale.
La problématique de la sécurité collective est mise notamment en avant par Pascal Boniface « dans un monde interconnecté, la sécurité est indivisible ».
II. Exemples concrets de cette coopération
La conquête spatiale
L’ISS est l’un des exemples les plus flagrants de cette coopération. La Station Spatiale Internationale implique le projet de plusieurs puissances, les États Unis, mais aussi la Russie, l’Europe, le Japon et le Canada.
Il s’agit d’un laboratoire scientifique dédié à la recherche spatiale. Cette coopération s’inscrit dans une logique complexe, à la fois axée sur les nouvelles technologies, les coûts engendrés, mais aussi tout ce qui touche à la logistique et à la science.
Le concept de diplomatie scientifique est notamment mis en avant par Pierre Bruno Ruffini, qui explique en quoi la science parvient à créer un lien indéniable entre les pays rivaux.
La conquête des fonds marins
En 1982, la mise en place de la CNUDM, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer représente un progrès considérable. Il s’agit d’apporter une série de réglementations sur l’exploitation et le partage des ressources marines. En 1994 est fondée l’AIFM, l’Autorité internationale des fonds marins. Elle met en place le principe du patrimoine commun de l’humanité.
En 1959, puis en 1991, le Traité sur l’Antarctique puis le Protocole de Madrid, établissent une coopération sur les fonds marins, avec plus de 50 États qui organisent des missions collectives.
Christian Buchet, spécialiste en histoire de la mer, explique que la gouvernance des océans est dorénavant un enjeu diplomatique.
La conquête du cyber espace
Dès les années 90, d’autres défis entrent en ligne de compte. Depuis le développement du net et du numérique, il y a bien davantage de risques liés à la sécurité. Les cyberattaques se multiplient et donc les États coopèrent dans le domaine de la cybersécurité.
Les informations sont davantage partagées dans le cyber espace, en lien avec les services de renseignements internationaux.
Laurence Devillers, qui est une experte en intelligence artificielle, met en avant la nécessité d’une coopération dans le domaine du cyberespace.
III. Apparition de nouvelles tensions, les limites de la coopération
Les rivalités réapparaissent
Les choses ont beaucoup évolué depuis les années 2010, et la coopération a encore ralenti, ou elle s’est tout du moins fragmentée, à cause de la rivalité qui n’a de cesse de s’accentuer entre les pays. La Chine est de plus en plus présente au niveau spatial, elle développe d’ailleurs sa propre station spatiale, Tiangong.
De nombreux groupes privés investissent dans le tourisme spatial et dans son exploitation, comme SpaceX par exemple, ce qui tend à fragiliser la coopération publique.
Certains auteurs reconnus comme Hubert Védrine ou encore François Heisbourg mettent en avant le fait que les intérêts des pays ont pris le pas sur la logique de collaboration.
Les inégalités qui existent dans la coopération
Il y a de plus en plus de volonté de puissance et de domination de la part des pays dans le domaine global de la conquête. La confiance peut être parfois limitée à cause d’initiatives prises de manière indépendante par certains pays. Les États Unis exercent une surveillance accrue avec la NSA.
Enfin, les changements politiques dans les pays peuvent arrêter brusquement la mise en avant de programmes communs. La guerre en Ukraine en 2022 a eu pour conséquence l’exclusion de la Russie de projets mondiaux.
Les problématiques éthiques liées à la coopération
Les questions sont de savoir comment éviter la pollution dans l’espace, qui est responsable en cas de litige, comment sauver les écosystèmes marins ?
Ces questions doivent donc faire l’objet d’une réflexion commune pour que des réponses pertinentes puissent être apportées.
Le sociologue Bruno Latour insiste sur le fait qu’il est important de faire face à une responsabilité collective.
Conclusion
La coopération est devenue essentielle dans la conquête de nouveaux espaces, et ce dès les années 1970. Ces espaces peuvent être soit physiques comme les fonds marins ou l’espace à proprement parler, ou bien plutôt virtuels, comme le cyberespace, qui prend bien entendu une place de plus en plus grande au fil des ans.
De nombreux défis restent à relever, et ce d’autant plus que cette coopération demeure fragile, à cause des tensions mondiales et des nouvelles rivalités qui apparaissent peu à peu.
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/le-coin-lecture/articles/homo-deus-de-yuval-noah-harari
https://www.iris-france.org/46434-strategie-dans-le-cyberespace-2/