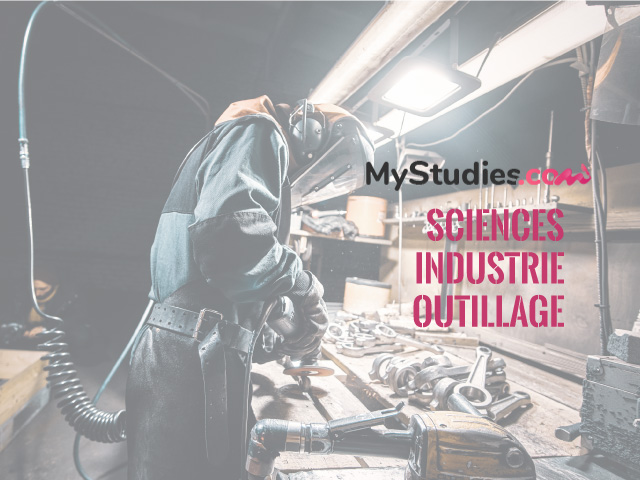La technologie se définit comme l’étude des techniques, des outils et des machines. La science, elle, se définit au sens général comme un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d’objets ou de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiés par la méthode expérimentale. La science renvoie aux branches de la connaissance, du savoir. L’esprit « scientifique » émerge au XVIIe siècle et marque le début de la science dite « moderne ». Au cours de l’histoire, les domaines scientifiques et technologiques ont évolué. De la révolution néolithique, en passant par les révolutions industrielles, ainsi que la révolution de la science dite « moderne », la science et ses évolutions façonnent les modes de vie humains et par là-même la structure sociale.
Ainsi les évolutions scientifiques et technologiques ont façonné pour l’homme son rapport au monde. Cette réflexion est présente dans des œuvres de science-fiction comme Le Tour du Monde en 80 Jours de Jules Verne, 2001 : L'Odyssée de l'Espace d'Arthur Clarke, et Un Éclat de Givre d'Estelle Faye.
Dans ce rapport nous comparerons les visions de ces trois œuvres et leur impact sur le monde industriel et créatif.
I. Jules Verne et Le Tour du Monde en 80 Jours : Le berceau de l’innovation technologique
1.1 L’environnement industriel à l'époque de Jules Verne
Le Tour du Monde en 80 Jours est un roman d'aventure qui a été écris à la seconde moitié du XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, où la technologie y est présentée comme un outil de progrès. C’est grâce à cela que à Phileas Fogg, le protagoniste va pouvoir faire le tour du monde en 80 jours : un exploit qui auparavant ne pouvait être envisagé. Et cela à l’aide de nouveaux moyens de transport tels que les chemins de fer et les bateaux à vapeur.
1.2 La technologie comme force créatrice
Présentée comme vecteur de découverte et de modernité, la technologie mise en avant dans ce livre est significative. Jules Verne avec sa vision imaginative, présente une image favorable ainsi qu’optimiste de l'innovation technique, capable de permettre de nouvelles aventures de voyages, de commerce et de communication. Par ailleurs l’optimisme de la fin du XIXe siècle face aux avancées scientifiques est également un point phare dans ce roman.
II. Arthur Clarke et 2001 : L'Odyssée de l'espace : La technologie pour l'exploration spatiale
2.1 Une vision technologique futuriste
L'Odyssée de l'espace, est un livre écrit par Arthur Clarke qui a été publié en 1968. Le climat qui émane de la lecture est une vision de la science et de la technologie prenant le dessus sur l’humain. HAL 9000 représente l’intelligence artificielle et ses progrès. C’est est un pilier central de l'intrigue qui interroge sur les écueils éventuels d’avancées trop importantes dans les technologies du domaine spatial.
2.2 Le contraste technologique : entre progrès et menace.
Dans ce livre Clark questionne la relation entre l'homme et la machine (un peu comme Descartes dans son dualisme mécaniste). Il évoque l’ambivalence entre la technologie comme futur outil indispensable pour l'exploration de l'univers, mais aussi une force potentiellement destructrice. Au cours de l’intrigue, l'intelligence artificielle prend des décisions autonomes ce qui pose des questions éthiques et renvoie à la nature de l’homme ainsi que la place de l’intelligence artificielle dans le futur de la société.
III. Estelle Faye et Un Éclat de Givre : La technologie dans un monde post-apocalyptique
3.1 Une approche dystopique de la technologie
Dans Un Éclat de Givre, qui a été publié au XIXe siècle, l’histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique où la technologie a perdu son statut dominant. L’auteur dépeint un monde où l'effondrement des structures industrielles et technologiques laisse place à une société en déclin. L’enjeu majeur est celui de la survie et non plus de l’innovation.
3.2 Le retour vers l’autonomie créatrice
Dans cette œuvre, la technologie devient un vestige du passé. Cette dernière se voit à l'arrière-plan d'une société en ruines. Estelle Faye par une mise en abyme dresse un futur qui se tourne vers le passé : on assiste au retour à un mode de vie plus autonome. Les les individus doivent se débrouiller de nouveau par eux-mêmes sans compter sur les avancées industrielles alors déchues. Cela contraste fortement avec la vision optimiste de Verne et la perspective ambivalente de Clarke.
Conclusion
Pour conclure : « la science et la technique étayent le mode industriel de production et imposent de ce fait la mise au rancart de tout outillage spécifiquement lié à un travail autonome et créateur ».
Nous voyons que les trois œuvres étudiées s’attardent sur la relation entre l’homme et la machine pour proposer des visions contrastées. Jules Verne semble optimiste vis-à-vis de l'essor de la technologie industrielle. Arthur Clarke, lui, met en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle et de la dépendance technologique pour l’Homme. Estelle Faye, quant à elle, illustre un futur où la technologie a échoué, ramenant l'humanité à une existence plus simple. On peut interpréter cela comme une tentative de faire face à l’angoisse fondamentale humaine pouvant exister, si l’Homme en venait à vouer aux avancées technologiques une croyance presque aveugle et déraisonnée afin de se rassurer peut-être. Quoiqu’il en soit, ces visions reflètent l'évolution de la société moderne et les questionnements quant à l'industrialisation et à l'autonomie créatrice que cette dernière porte en elle. Il est important de souligner que la technique, issue du terme grec « tékhne » est propre à l’homme dans ses diverses évolutions à travers le temps. Même si les avancées industrielles et technologiques ont amené l’humain à dépasser ses limites voire les repousser jusqu’à même le scientisme aujourd’hui, la question d’une relation systématique entre technique et création ne date pas d’hier. Si les auteurs étudiés dans ce rapport appartiennent à l’époque moderne, l’héritage de la pensée classique Aristotélico-Thomiste ayant traversé le Moyen-Age pour évoluer jusqu’à une conception cartésienne s’est aussi porté sur la nature de l’homme et le rapport entre technique et autonomie créatrice. Si l’évolution de la pensée philosophique classique vers les auteurs modernes étudiés peut se traduire par le passage de l’hétéronomie à l’autonomie, alors il faut comprendre que les évolutions techniques ne peuvent aboutir à une aliénation du travailleur si elles sont subordonnées à des finalités humaines. Si Tocqueville avait mis en garde sur les écueils de la « démocratie » lors de son triomphe avenant lorsqu’il dit « Je vois dans l’égalité des conditions deux tendances : une de chaque homme vers des pensées nouvelles, et une qui ne le réduirait à plus penser. », il semblerait que les auteurs étudiés en surplus un élan optimiste évoquent aussi le besoin fondamental de ne pas perdre le travail créatif malgré les avancées technologiques, au risque d’un déclin social…
BIBLIOGRAPHIE
Descartes, René, Discours de la méthode. 1637.
De Tocqueville, Alexis, De la démocratie en Amérique. 1835.
Verne, Jules. Le Tour du Monde en 80 Jours. 1872.
Clarke, Arthur. 2001 : L'Odyssée de l'Espace. 1968.
Faye, Estelle. Un Éclat de Givre. 2014.